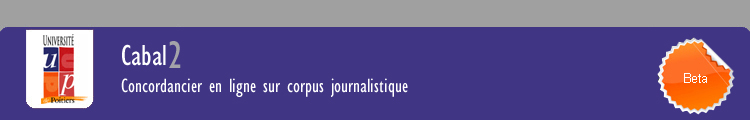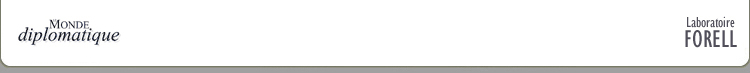-->
| 1. Une femme est-elle libre de pratiquer le sport de son choix ? Dans les pays occidentaux, cela ne prête guère à discussion : si les femmes s’investissent majoritairement dans les disciplines "gracieuses" et répugnent aux sports "virils", c’est que tel est leur choix. A y regarder de près, pourtant, cette propension n’est qu’une construction sociale, qui réglemente les représentations et les pratiques "acceptables" du corps, et perpétue la division des rôles. Aux hommes le "faire", aux femmes le "plaire". |
|
1. Is a woman free to choose which sport she goes in for ? In western countries the question hardly arises : if women mainly take part in the graceful disciplines and avoid the manly sports, it is because they choose to. But is this just a social construct that perpetuates the assigning of roles ? |
-->
-->
| 2. Sur les terrains de sport, les femmes ne sont plus jugées comme inconvenantes ou incapables. De plus en plus d’entre elles pratiquent une activité physique régulière (64 % des femmes de 14 à 65 ans, et 72 % des hommes) et tous les sports leur sont en théorie ouverts. Mais les pratiques sportives, comme on peut le constater à Sydney à l’occasion des Jeux olympiques, restent des territoires sexués. |
|
2. On the sports field, women are no longer seen as out of place or out of their league. More and more of them go in for regular physical activity (64% of women aged 14 to 65, as against 72% of men) and in theory they can practice any sport. But as we can see at the Sydney Olympics, sports are still gender-centred. |
-->
-->
| 3. Dès l’enfance, les filles manifestent un intérêt moindre que les garçons pour les situations d’affrontement et de rivalité, et à se mesurer aux autres. Modalités majoritaires de la pratique masculine du sport : technique, entraînement, attachement aux valeurs traditionnellement instituées du succès (performances, clas sements), collectif, solidaire. Pour les femmes, en revanche, le jeu, l’entretien physique, l’attachement aux finalités personnelles ou aux aspects relationnels sont prépondérants, dans une pratique individuelle, voire solitaire. Comme si ce devait être plus volontiers sport pour eux et corps pour elles. On ne saurait laisser les attributs de son sexe au vestiaire. |
|
3. From childhood girls show less interest than boys in situations that involve confrontation and rivalry, and in matching themselves against others. For men, sport means technique, training, performance and ranking (the traditional value-system for measuring success), teams and team spirit. For women, on the other hand, what matters most is enjoying the game, maintaining physical tone, pursuing personal goals, performing as individuals. It is more a matter of sport for him, and body for her. Sexual characteristics do not get left behind in the dressing room. |
-->
-->
| 4. Les modes d’engagement sportif des hommes et des femmes traduisent en effet la façon qu’ils ont d’investir l’espace et le monde. Les représentations "permises" dans le sport sont les mêmes que les métiers "autorisés" aux femmes. |
|
4. (...) |
-->
-->
| 5. Montrer ou exercer sa force, se livrer à un combat, porter ou recevoir des coups, prendre des risques corporels sont autant d’attributs que les femmes semblent ne pas pouvoir faire leurs et qui appartiendraient donc, en propre, à la masculinité. |
|
5. (...) |
-->
-->
| 6. En prêtant attention à ce que les femmes font, à ce qu’on montre d’elles, à ce qui est dit d’elles (et à ce qui n’est ni dit ni vu), on voit se dessiner des normes d’apparence corporelle : une prescription de féminité. Les femmes sportives posent (malgré elles) la question du corps et de la féminité conformes à la désirabilité sociale. |
|
6. When we look at what women do - and what is shown or said about what they do - we can see standards being set for how they ought to look. They have to look feminine. Whether they want to or not, women in sport raise the question of the body and femininity according to what society regards as desirable. |
-->
-->
| 7. Les femmes sont quasi absentes de l’information et, quand elles y sont présentes, c’est de manière stéréotypée : rapportés à la sphère affective ou sexuelle, à la famille, aux enfants. Alors que l’ensemble de la profession de journaliste compte un tiers de femmes, elles sont quasiment absentes du journalisme sportif (90 femmes sur 1 800 journalistes affiliés à l’USJSF). Lors des Jeux olympiques d’Atlanta, en 1996, on ne comptait que 10 % de femmes parmi les journalistes français accrédités. Conséquence ? Si les femmes représentent en France 30 % des sportifs de haut niveau, elles ne sont plus que 10 % des athlètes cités dans les médias. Pour se frayer un chemin dans les pages des magazines, les sportives doivent impérativement gagner. |
|
7. Women are almost never in the sports news. When they are, the approach is stereotypical : love life, sex life, family, children. A third of all journalists may be women but hardly any are sports writers (90 out of 1,800 members of the French sports-writers’ union). During the Atlanta games in 1996, only 10% of the accredited journalists from France were women. The result is that while 30% of France’s top-level athletes are women, they only account for 10% of media coverage. To fight their way onto the magazine pages, sportswomen absolutely have to win. |
-->
-->
| 8. Le sport féminin représente en moyenne 16 % du volume occupé par les pages sportives..., qui ne comptent que pour 1 % des pages dans la presse "féminine". La télévision française, en 1997, a consacré les deux tiers de ses retransmissions aux sports les plus masculins (football, cyclisme, rugby, sports mécaniques, boxe). Le tennis, l’athlétisme et le golf, où figurent quelques sportives, n’ont représenté que 17 % du temps total... restaient les 25 heures (1,2 % du total) de patinage, un sport assurément féminin. Où il est question de "grâce" des gestuels et des figures, où les apparences sont travaillées à travers les tenues et le maquillage, où le corps productif, en fin de compte, importe moins que le corps esthétique : là sont les sports féminins qui retiennent l’attention, l’audience. |
|
8. Women’s sport gets on average 16% of the column inches on the sports pages - and only 1% of pages in women’s journals. In 1997 French TV devoted two-thirds of its broadcasts to the most male sports (football, cycling, rugby, motor sport and boxing). Tennis, athletics and golf, where women do take part, got only 17% of the total air time. That left 1.2% of coverage (25 hours) for skating, most certainly a feminine sport. A sport where what matters is gracefulness in movement and body, where appearance is enhanced by clothes and make-up —where, when it comes down to it, what the body does is less important than how the body looks. This is the sort of women’s sport that gets the attention and pull in the audiences. |
-->
-->
| 9. Ecoutons les journalistes sportifs : l’homme est décrit dans ce qu’il fait ; lorsqu’il s’agit de la femme, impossible d’échapper à une appréciation esthétique. Lorsque la sportive paraît, cherchez la femme : "La toujours belle et toujours aussi rapide Florence Griffith Joyner", ou l’alpiniste Catherine Destivelle, qui, "tranquillement redoutable derrière son joli sourire, arrive toujours au sommet". L’Equipe magazine n’avait pas hésité à opposer, sur la question de la "féminité", la cycliste Jeannie Longo à Muriel Hermine (natation synchronisée). En légendant une photographie de cette dernière ("belle et féminine"), le journaliste indiquait : "La faute à qui si Longo rime avec macho et Hermine avec féminine ?" L’une était conforme au référent normatif de la "féminité", l’autre non. |
|
9. So what do the sports journalists say ? They describe a man in terms of what he does but when it’s a women, they can’t get away from how she looks. "A sportswoman is first and foremost a woman, like the always lovely, and always fast, Florence Griffith Joyner" or the climber Catherine Destivelle who "quietly formidable behind her pretty smile, always gets to the top". Equipe Magazine felt entitled to draw a comparison, on this subject of femininity, between the cyclist Jeannie Longo and swimmer Muriel Hermine. A caption to a photo of Hermine (both beautiful and "feminine") read "Whose fault is it if Longo rhymes with macho, and Hermine with feminine ?". One came up to the magazine’s standard of femininity ; the other did not. |
-->
-->
| 10. La pratiquante de natation synchronisée, la danseuse, la gymnaste ou la patineuse représentent le "modèle" de la femme sportive. On le perçoit bien lorsque les femmes s’adonnent à des sports "de tradition masculine", ou quand elles ont des morphologies différentes de cette femme "canon". Ainsi en cyclisme : "L’ascension sur Morzine, en particulier, permet de convaincre les milliers de spectateurs présents que les filles, elles aussi, savaient tenir sur un vélo. Certes, il serait plus féminin de les imaginer actrices ou mannequins, mais il serait bon que l’homme, en 1985, comprenne enfin que la femme n’a pas pour rôle permanent d’être féminine afin de séduire le mâle. Quelques filles du peloton d’ailleurs nous soulignons n’ont pas grand-chose à envier question physique aux modèles de Play-boy. Enlevez leur cuissard, maquillez-les et vous ne serez pas déçu." |
|
10. Swimmers, dancers, gymnasts, skaters — these are the proper models for a sportswoman. "This is very clear when women take up traditionally male sports or when they differ physically from the standard woman". Take cycling. Here is Equipe : "The stiff Morzine climb was enough to convince thousands of spectators there that the girls, too, have stamina on a bike. Agreed, it would be more feminine to think of them as actresses or models on the catwalk, but men, in 1985, should wake up to the fact that a woman’s lifelong role is not to be feminine just to attract a man. Anyway, some of the girls in the bunch don’t have to feel envious of a Playboy model in the looks department. Take off the cycling shorts, put on some make-up, and you wouldn’t be disappointed". |
-->
-->
| 11. Sous le maillot, comme sous ces propos ambigus, c’est bien LA femme que l’on cherche... et que l’on exige. Les sportives des pays de l’Est n’étaient-elles pas décrites, à la fin des années 80, comme des "erreurs de la nature" et des "monstres" ? Le sport se pose à la fois en conservatoire d’une excellence féminine stéréotypée et en conservatoire des vertus viriles. La diversité des morphologies appartient à des concevables masculins ; on imagine mal qu’un sauteur en hauteur puisse avoir la même corpulence qu’un lanceur de poids. Mais on voudrait des sportives qu’elles soient toutes semblables, minces et longilignes, comme si, pour elles, l’efficacité gestuelle et technique pouvait être indépendante des capacités physiques et des pré-requis morphologiques. |
|
11. Beneath the Lycra, and behind the veiled comments, it is woman with a capital W they are asking for. Remember, in the late 1980s, sportswomen from eastern Europe being described as "monsters" and "nature’s mistakes". Sport aims to be at one and the same time a repository of stereotyped feminine excellence and of all the manly virtues. But though different body shapes can readily be conceived of among the men —it is hard to imagine a high-jumper with the corpulence of a shot-putter— sportswomen are all expected to look the same. Tall and slim. As if, in their case, movement and technique can be quite independent of the physical capacity and the build needed for them. |
-->
-->
| 12. "Le sport menace-t-il leur beauté ?", question récurrente se conjuguant exclusivement au féminin : "Il n’y a rien de plus beau au monde qu’une Mary Decker qui court. Ses adorables jambes, qui eurent à juste titre les honneurs d’un grand magazine américain, engendrent une foulée qui demeure sans cesse élégante et racée, même nous soulignons au plus profond de l’effort." La sportive est tenue de faire la démonstration (sinon la preuve) de son identité en usant des artifices propres aux femmes : cheveux mis en forme, bijoux, maquillage ou ongles vernis (comme ce fut demandé à toutes les participantes de la Grande Boucle —le Tour de France féminin— en 1999). Par ces signes, de surface, mais donnés comme constitutifs de la féminité, les sportives peuvent espérer être perçues pour ce qu’elles sont et aussi pour ce qu’elles font. Manqueraient-ils, que se déchaînent volontiers la suspicion, l’inquiétude et une violence verbale à peine contenue. |
|
12. "Is sport threatening their looks ?" We hear the question time and again, and only ever about women. "There is nothing lovelier in the world than a Mary Decker running. Those adorable legs — very rightly done full honours in a leading American magazine— produce a stride that still keeps the endless elegance of a thoroughbred even when she’s working hardest". A woman in sport is supposed to demonstrate (if not indeed prove) her identity by using the artifices proper to a woman : nicely-done hair, jewellery, make-up and varnished nails (as was required of all women competitors in the Grande Boucle —the female Tour de France— in 1999). By providing signs like these, superficial perhaps, but still put forward as what femininity is made of, sportswomen can hope to be seen both for what they are and what they do. If the signs are lacking, this quickly unleashes suspicion, disquiet and barely-contained verbal venom. |
-->
-->
| 13. A bien regarder les marginalités tolérées et celles qui ne le sont pas, deux terrains d’expression de la virilité se dégagent : l’un fait de connaissances et de savoir-faire, l’autre, plus "personnel", fait d’usages et d’images du corps — l’un et l’autre caractérisant l’homme dans son rapport aux autres, aux objets, au monde extérieur. Les femmes peuvent, sans trop déroger, s’approprier certaines prérogatives du premier (voir la reconnaissance de Florence Arthaud, Michèle Mouton, Catherine Destivelle), mais elles violent un tabou quand elles s’arrogent certains aspects du second (boxeuses, lutteuses, joueuses de rugby demeurent invisibles dans les médias). |
|
13. If we look at marginal cases that are tolerated and those that are not, we can see two areas through which virility is expressed. One involves knowledge and know-how, while the other - more personal —has to do with the use made of the body and its image. Both of them characterise man in his relationship to others, to objects and to the outside world. Women can, without offending too much against the established order of things, take on some of the first set of prerogatives (witness the recognition given to Florence Arthaud, Michèle Mouton or Catherine Destivelle). But they are breaking a taboo if they seize for themselves any aspects of the second (women boxers, wrestlers and rugby- players are still quite invisible in the media). |
-->
-->
| 14. Elles subissent alors un procès de virilisation, qui demeure d’actualité dans le sport quand ailleurs il est tombé en désuétude. Comme les écrivaines et artistes d’autrefois, dès que des femmes sortent des espaces et des rôles qui leur sont strictement assignés, elles sont désignées comme masculines, "viriles", voire asexuées. Rompant avec le rôle imparti aux femmes, elles ne peuvent que se masculiniser. |
|
14. They then undergo a process of "virilisation", something still present in the world of sport while it has long faded elsewhere. Like the women writers and artists of the past, women are, as soon as they move out of their assigned places and roles, reclassified as being masculine, manly, if not indeed sexless. Breaking with the role women have been allotted, the only thing they can do is make themselves a man. |
-->
-->
| 15. Les "affaires" de doute quant au sexe réel des athlètes sont anciennes. Dans la première moitié du XXe siècle, il est commun de penser que le sport virilise les femmes. Ce "trop de virilité" amènera à la mise en place du test de féminité comme à la suspicion de la prise d’hormones mâles par les sportives dans les années 60. Au fil du temps, les morphotypes des sportives se sont, de fait, rapprochés de ceux des sportifs : gestuels et efficacité technique se ressemblent, tout comme les corps, dans leur apparence comme au plan fonctionnel. Le physique avantageux des sportives, du fait de la nature, de l’entraînement ou de l’absorption d’androgènes, est indistinctement rapporté à ce procès récurrent. Leur virilisation "naturelle" ou "artificielle" et la suspicion quant à leur féminité se confondent durablement dans l’histoire. Comme on a pu le remarquer avec Amélie Mauresmo, l’homosexualité (déclarée ou présumée) amène à ce même procès : sont- elles de vraies femmes ? |
|
15. The cases of doubt being cast on the true sex of athletes go back a long way. It was a common belief in the first half of the 20th century that sport made women masculine. This "excess of masculinity" led to the introduction of a test for femaleness, and to the suspicion in the 1960s that sportswomen were taking male hormones. Over time the morphotypes of sportswomen have in fact moved closer to those of the men ; their body movements and technical efficiency have become similar, just as their bodies have, both in appearance and function. By nature, training or the absorption of androgens, the physique of women is linked in an unclear way to this recurrent process. Their "natural or artificial virilisation" and suspicions about their femininity have over the years become firmly intertwined. As in the case of Amélie Mauresmo, lesbianism (declared or presumed) leads to the same thing —are they, it is asked, real women ? |
-->
-->
| 16. Le sport réclame de "vraies" femmes et de "vrais" hommes au sens le plus classique. Or la pratique sportive amène la question de la ressemblance voire de la confusion entre hommes et femmes. Ici, le corps n’est jamais évacué. Il est le vecteur premier où s’inscrit l’identité de chacun. Le corps du sportif est agissant, donné à voir, vu et perçu. |
|
16. Sport demands "real" women and "real" men in the classic sense of the word. But it also brings up the question of similarity, or indeed confusion, between men and women. In sport, the body is never removed from the equation. It is the prime vector through which each person’s identity is proclaimed. The body of the sportsman and — woman is always on view, seen and perceived. |
-->
-->
| 17. A travers cette représentation des corps, le sport devient le lieu où se joue l’imaginaire de l’Autre. Une masculinité et une féminité dessinées par leurs dif férences les plus accusées s’y expriment et s’y mettent en scène. Le sport veut et forge des femmes idéales, belles pour (le) séduire, de même que des hommes idéalement virils, c’est-à-dire forts ou courageux pour (la) conquérir. Les pratiques, les images et les discours du sport ont ce point commun : c’est l’image qu’elle donne à voir d’elle-même qui fait la femme, comme c’est l’action qui fait l’homme. |
|
17. Via this representation of bodies, sport become a locus where the mind’s-eye picture of the other holds sway. It is where maleness and femaleness, delineated by their most evident differences, express and display themselves. Sport wants ideal women, beautiful in order to be attractive (to him), just as it creates ideally masculine men (strong or courageous), made to conquer (her). Sporting practices, images and talk all have this point in common : it is the image she offers of herself that makes the woman : action that makes the man. |
-->
-->
| 18. Aux balbutiements du sport féminin, le baron Pierre de Coubertin traçait les limites de l’acceptable : "Techniquement, les footballeuses ou les boxeuses qu’on a déjà tenté d’exhiber çà et là ne présentent aucun intérêt, ce seront toujours d’imparfaites doublures. (...) si les femmes sportives sont soigneusement dégagées de l’élément spectacle, il n’y a aucune raison de les proscrire. On verra ce qui en résulte." Et l’on dira des gymnastes, dans les années 40, qu’ "elles ne devraient jamais donner, aux barres parallèles, le spectacle de visages grimaçants, de contractions douloureuses en cours d’exercices, de chutes pénibles". |
|
18. At the infancy of sport for women, Baron Pierre de Coubertin mapped out the limits of the acceptable : "Technically, the women footballers or boxers people have already tried to put on show here and there hold no interest, and they will always be imperfect stand-ins ... If sportswomen are kept carefully apart from the element of spectacle, there is no reason to ban them. We shall see what becomes of them". And in the 1940s it was said of women gymnasts that "they should never, on the parallel bars, provide the spectacle of distorted faces, painful contractions during the exercises, and of nasty falls". |
-->
-->
| 19. Les images de sportives saisies au coeur de l’effort restent minoritaires, quand elles ne sont pas montrées comme contre-exemples. Ainsi, lors du premier marathon olympique féminin, en 1984 à Los Angeles, les caméras restèrent longuement braquées sur l’arrivée de cette concurrente grimaçante et titubante... L’image, maintes fois rediffusée, de Florence Griffith Joyner remportant le 100 mètres olympique de Séoul, en 1988, fut bien celle non de son ultime effort avant la ligne d’arrivée, mais de son sourire une fois qu’elle l’eut franchie. |
|
19. There are very few pictures of sportswomen taken at the peak of effort, unless they are being shown to put the viewer off. Thus, when the first Olympic women’s marathon was run in Los Angeles in 1984, the cameras dwelt interminably on the arrival of a competitor with her face screwed up, staggering from side to side. But the picture, reshown a thousand times, of Florence Griffith Joyner winning the Olympic 100 metres at Seoul in 1988 was taken not at the moment of maximum effort just before reaching the finishing line, but of her smile after crossing it. |
-->
-->
| 20. A travers une sportive qui n’est femme que gracieuse, souriante ou parée, les prescriptions ne s’adressent-elles pas à une seule et même femme - celle qu’on ne peut s’empêcher, fantasmatiquement au moins, de vouloir physiquement posséder, celle qui doit réserver certains de ses visages (comme celui de la souffrance) à l’intimité et à un seul homme ? Dans Les Olympiques (1954), Henry de Montherlant écrit : "En aurai-je vu, de ces jeunes sportives, offrir au regard des curieux, sous l’oeil de leurs mères, ce dernier secret que lâche une face défigurée, ce spasme de douleur où l’époux seul jadis avait le droit de se perdre en étant le créateur et le maître." La sportive souriante, dont on vante la "féminité", et la sportive dite trop musclée, anguleuse, "masculine", sont ainsi les deux faces d’une même icône. |
|
20. It seems the prescriptions are being aimed, via a sportswoman who is a woman only if she is graceful, smiling and adorned, at just one universal woman. At the woman whom one cannot help wanting to possess physically - at any rate in one’s fantasies. She who must keep some of her faces (like the one that shows suffering) for her private life and for just one man. In Les Olympiques (1954), Henri de Montherlant wrote : "Shall I have seen them, these young sportswomen, offering to the eyes of the curious bystander, as their mothers look on, that final secret revealed by a distorted face, that spasm of pain in which until now only the husband has, as creator and master, had the right to immerse himself ?" So the smiling sportswoman whose femininity is praised and the other, who is called too muscular, too angular, too "masculine", are two faces of the same icon. |
-->
-->
| 21. Comment s’étonner alors que les représentations traditionnelles se reproduisent sur les terrains de sport, sur les lieux (et à l’âge) de la découverte de son corps en transformation, quand se dessinent les contours de la masculinité et de la féminité ? Dès le plus jeune âge, on fait jouer les garçons et les filles sur des terrains différents. Les pratiques qu’on leur propose (ou impose) à l’école ou au club sont aussi à repenser : que viendraient faire les filles dans un club si elles ne se reconnaissent pas dans les modalités de compétition qui y sont à l’oeuvre ? |
|
21. Is it surprising, then, that the traditional ways of showing men and women are reproduced on the sports field, in the place where (and at the age when) they are discovering their changing bodies and the contours of masculinity and femininity are beginning to take shape ?. From the youngest age, boys and girls are given different sports grounds to play on. The kinds of sport suggested to them (or imposed on them) at school and in the sports club need rethinking, too. What are girls doing in a club if they do not see a place for them in the kinds of competition that go on there ? |
-->
|